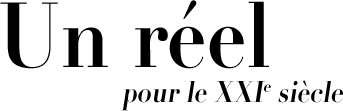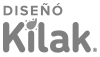S'inscrire à la FÊTE
Inscription COMPLET
What's up ! NEWS
Comité d'action de l'École Une - Papers
Textes d'orientation
Affinités VIDÉO
5 minutes à la RADIO
Affinités À LIRE
Bouts de réel WAP WEB
Journée clinique
Bibliographie
Publications
Dossier de PRESSE
Informations pratiques
Les Congrès précédents
@scilitwitt !
Propos recueillis par Caroline Leduc et Aurélie Pfauwadel [1]
 |
| Né en 1972, Elie During est maître de conférences en philosophie à l'Université de Paris Ouest – Nanterre et membre de l'Institut Universitaire de France. Il est notamment l'auteur de Faux raccords : la coexistence des images (Actes Sud, 2010) et de trois ouvrages à paraître en 2014 : Le Futur n'existe pas (avec Alain Bublex, chez B42), Temps flottants (Bayard), Bergson et Einstein : la querelle du temps (PUF). Il a travaillé à l'édition critique des œuvres de Bergson aux Presses Universitaires de France (Durée et Simultanéité : à propos de la théorie d'Einstein, 2009 ; Le souvenir du présent et la fausse reconnaissance, 2012). Membre du comité de rédaction de la revue Critique, il a co-dirigé plusieurs collectifs consacrés au cinéma et à l'art contemporain : Cinéphilosophie (Critique, 2005), In actu : de l'expérimental dans l'art (Presses du réel, 2009), À quoi pense l'art contemporain ? (Critique, 2010). Page web personnelle : http://www.ciepfc.fr/spip.php?article93 |
Le même temps ?
Aurélie Pfauwadel : La querelle du temps entre Einstein et Bergson, à laquelle vous vous êtes beaucoup intéressé, remonte aux années 1920. Quelle est l'actualité de ces problèmes au XXIe siècle ?
Élie During : Le différend entre science physique et philosophie n'est toujours pas réglé aujourd'hui. La question centrale est celle de la coexistence. Autour de ce problème, les régimes de discours n'arrivent pas à s'accorder, ce qui est aggravé par la spécialisation croissante de la machine scientifique. Très peu de gens actuellement, à moins d'avoir une formation de physicien, parviennent à rattacher les problèmes métaphysiques de philosophie générale et les questions qui intéressent les scientifiques.
A.P. : Quel est ce problème de la coexistence que vous pointez ?
E.D. : Il y a un siècle, la relativité suscitait la perplexité des philosophes en annonçant avec fracas qu'il n'y avait plus moyen de donner à l'idée de simultanéité un sens absolu, c'est-à-dire objectif, invariant. La notion d'un présent commun où coexisterait tout ce qui est, l'idée d'un front du devenir rassemblant tout ce qui existe en acte ou qui se réalise à un moment donné, s'en trouve fragilisée. Il me semble que ce problème de la simultanéité, de la coexistence paradoxale des choses, est toujours actuel : il s'agit de prendre acte de la relativité de la simultanéité au sens physique, tout en s'efforçant de penser l'unité d'événements distants, qui paraissent temporellement déconnectés.
Quand on pense au temps, l'image qui s'impose le plus souvent est celle du fleuve (qui s'écoule), ou alors de la flèche (le vecteur passé-présent-futur). Dans les deux cas la durée revêt un caractère linéaire : que ce soit le temps homogène, uniforme et métrique de la mécanique classique ou celui de la phénoménologie, saisi comme courant de conscience, le propre du temps est de passer. Et ce passage lui-même pose évidemment des problèmes propres. Mais l'idée de simultanéité, qui constitue la dimension latérale du temps, pose des difficultés tout aussi profondes, et cet aspect a généralement été négligé, pour des raisons qui tiennent au primat de la conscience et d'une certaine idée du temps « vécu ».
La fin du temps global
A.P. : Que signifie, concrètement, que la simultanéité est relative ?
E.D. : Si vous associez, par exemple, un système de référence au café de la place Clichy où nous sommes lorsqu'il est 18h34 à nos montres, et un autre à un bolide qui passe à ce moment précis juste à côté de nous, si possible à très grande vitesse, alors deux événements qui sont simultanés pour moi, ici-maintenant, seront successifs pour tout observateur associé au bolide. Le seul moyen de raccorder ces observations (car tout cela est en principe observable) est de les envisager formellement comme deux perspectives sur (ou dans) l'espace-temps : Einstein a montré qu'on peut passer de l'une à l'autre à la faveur de transformations algébriques qui ont pour caractéristique d'échanger des valeurs temporelles contre des valeurs spatiales. Tout cela est aujourd'hui couramment confirmé par l'usage des technologies du type GPS, qui tiennent compte des distorsions spatio-temporelles prévues par la relativité (dislocation des simultanéité, dilatation des durées). Au fond la théorie de la relativité nous oblige à prendre au sérieux l'idée que le temps d'un événement ou d'un processus est soumis, comme l'espace, à des lois de perspective.
Caroline Leduc : Comment la physique définit-elle une perspective ?
E.D. : C'est simplement un système de coordonnées – trois coordonnées d'espace et une de temps – attachée à un objet mobile. Les physiciens parlent de « référentiel ». C'est en fait une perspective mobile, une perspective cinématique. Dans l'espace, tout bouge par rapport à tout. Il y a autant de systèmes de référence que de mouvements différents.
A.P. : La leçon d'Einstein et de Bergson, c'est donc qu'il n'y a pas de temps absolu, de durée universelle ?
E.D. : Bergson l'avait pressenti mais sur des bases différentes, en réaction à l'idée newtonienne d'un temps absolu, mathématique, uniforme. Les affirmations d'Einstein l'intéressaient pour penser une pluralité des durées qui se déploient en gerbe, sans avoir à être totalisées, ou en l'occurrence synchronisées, par une horloge universelle. Pourtant Bergson butait sur un point : il avait bien vu que si on déroule jusqu'au bout les conséquences de la vision einsteinienne du temps physique, on aboutit à la dissolution de toute idée de temps global. Si on laisse de côté les temps perspectifs ou relatifs, qui sont au fond des constructions arbitraires, il ne reste plus qu'un temps local – le seul qui ait une objectivité physique, parce qu'on peut l'associer à des processus qu'on suit de proche en proche, suivant les lois de la causalité ou de l'action par contact. Mais ce temps local est un temps sans aucune épaisseur, incapable de s'étendre simultanément à une multiplicité de lignes de devenir distribuées dans l'espace. Il n'offre qu'une version décharnée du temps vécu. Einstein conçoit une pluralité de temporalités locales disjointes ; Bergson tient à conserver au devenir sa portée globale : il veut penser l'unité temporelle des flux de la nature, sans revenir pour autant au temps universel à la Newton. C'est là leur pomme de discorde.
L'espace-temps est-il réel ?
A.P. : Chez Bergson, le fond du réel, c'est la durée – fond métaphysique dissout par Einstein…
E.D. : Oui. Et la fonction cosmologique de la durée est de rendre pensable la conjonction et la solidarité des choses en durée : la manière dont elles se continuent ou se prolongent les unes dans les autres, non seulement dans l'ordre de la succession, mais de la coexistence. Bergson tient à l'idée selon laquelle les durées disjointes engrènent les unes sur les autres, et constituent ainsi, de proche en proche, une sorte de grand tissu unitaire. C'est la marque de son classicisme. Il s'agit de resituer le temps vécu, le temps de la conscience humaine, dans un temps universel. Or c'est précisément ce qui devient très problématique chez Einstein, puisque la forme espace-temps qu'il propose pour totaliser les choses n'est au fond rien d'autre qu'une géométrie de l'univers à quatre dimensions, qui n'a plus rien de spécifiquement temporel.
A.P. : Ce concept d'espace-temps, qui sert communément de cadre à l'appréhension du réel, est remis en cause aujourd'hui dans certaines branches de la physique.
E.D. : En effet, du côté de la gravité quantique, cette branche de la physique qui essaie d'unifier les théories de la gravitation et la physique quantique, on se demande si l'espace-temps n'impose pas d'emblée un formalisme trop violent, qui empêche de penser certaines relations plus fondamentales. On suggère par exemple une idée du changement qui serait indépendante de la toile de fond « espace-temps », et peut-être de l'idée même de dimension : une temporalité qui émergerait à partir de quelque chose comme une variation pure. On cherche en somme à rendre compte du temps, et pas seulement de ce qui a lieu dans le temps. Il n'est possible ici d'en parler que métaphoriquement.
Le réel est discontinu
C.L. : Dans son Séminaire « Les noms dupes errent », Lacan situe le temps au point où se resserrent les trois cordes du nœud borroméen : « entre votre symbolique, votre imaginaire et votre réel, depuis le temps que je vous le ressasse, vous ne sentez pas que votre temps se passe à être tiraillé ? »[2] Le temps ne serait alors rien d'autre, poursuit Lacan, que la succession des instants de tiraillement dans le nœud.
E.D. : Ce qui me frappe, c'est la volonté commune à Lacan et d'autres penseurs du XXe siècle, comme Bachelard, de réengendrer l'expérience de la durée à partir d'événements discontinus. Ici, il est question de points de tension dont la connexion, de proche en proche, formerait l'expérience du temps. Ce qui me frappe, c'est que Lacan en fait la genèse sans présupposer une dimension temporelle qui ordonnerait les phénomènes. C'est une démarche globalement anti-bergsonienne, qui rejoint d'ailleurs les intuitions de la physique contemporaine. Le premier geste d'Einstein, comme l'a bien vu Bachelard, consiste à atomiser les processus, à penser des « points-événements » discrets qui servent ensuite de base pour saisir des évolutions continues. De ce point de vue, le réel – en tout cas la forme dans laquelle nous l'accueillons – se distingue par son caractère nettement discontinu.
C.L. : Vous êtes-vous intéressé à l'appréhension psychanalytique du temps ? La polyrythmie est patente entre les modalités du temps de l'inconscient et celles de la conscience.
E.D. : Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, c'est que les modèles temporels les plus opérants ne sont pas des modèles de temps linéaires, mais supposent la coexistence de strates distinctes et simultanément actives. La question est de savoir ce que signifie l'opération qui consiste à tenir ensemble ces temporalités a priori déconnectées. La psychanalyse me paraît s'intéresser davantage à l'aspect archéologique qu'aux processus évolutifs, à la juxtaposition des choses – ou à leur conjonction dans le simultané – qu'à leur ordonnancement successif. Mais parvient-elle à modéliser le temps sans le perdre, sans tout rabattre sur la dimension spatiale ?
A.P. : Pour Freud, l'inconscient ne connaît pas le temps. Lacan pense cela en terme de structure, et il donne le primat aux temps logiques sur le temps chronologique – mais cela reste du temps.
E.D. : Le problème devient alors celui de l'articulation de la structure à la dimension événementielle. Ce dire de Freud est pour moi problématique. Dans le texte de Malaise dans la civilisation où il compare l'inconscient à la ville de Rome, dans laquelle coexistent activement toutes les strates historiques, il déploie une conception foncièrement détemporalisée du temps : une vision synoptique permet de saisir ensemble les histoires passées et présentes de la ville, mais aussi toutes ses histoires virtuelles – ce qu'aurait été Rome si la civilisation romaine ne s'était pas effondrée sur elle-même, etc. Et c'est peut-être là, dans cette dimension uchronique, que la dimension temporelle insiste malgré tout : le temps présent est tissé, en filigrane, de lignes de temps virtuelles qui ne sont pas réalisées.
La structuration désirante du temps
A.P. : Dans le Séminaire XI, Lacan dit justement de l'inconscient que c'est du « non né », du « non réalisé » ! Mais, la question à laquelle vous vous intéressez le plus est celle de la simultanéité intersubjective, n'est-ce pas ?
E.D. : Oui, je cultive un étonnement un peu enfantin face à cette évidence : les gens qui ne sont pas là, qui disparaissent de mon horizon perceptif ou phénoménologique – a fortiori les gens à l'autre bout de la planète – continuent néanmoins de vivre leur vie. Que veut dire de vivre déconnectés, séparés, et malgré tout ensemble ? Car nous appartenons bien à une même enveloppe temporelle – une enveloppe de simultanéité –, comme le prouve le fait qu'en général on peut se retrouver réunis. Que se passe-t-il dans l'intervalle ? Comment penser cet intervalle autrement que de manière spatiale ? C'est cette affaire de temporalités distantes sans être disjointes, simultanées sans être synchrones, si l'on veut, qui m'intéresse. Ce n'est plus le plenum où tout communique ; c'est une sorte de nexus distendu.
A.P. : Freud formalise avec le jeu du Fort / Da cette question de la présence et de l'absence : la toute première symbolisation de l'enfant consiste justement à pouvoir se représenter le fait que sa mère n'existe pas seulement dans sa pure présence corporelle perceptible, mais qu'elle existe encore une fois la porte fermée. C'est donc une affaire de symbolique !
E.D. : Mais justement, si l'enfant peut se rapporter à l'absent comme tel par l'entremise du symbolique, la dimension proprement temporelle n'intervient pas à ce niveau-là. En tout cas elle ne permet pas encore de poser la question de la communauté ou de la simultanéité des temps, la question de savoir comment elle occupe son temps à elle, comment son temps à elle se déroule en parallèle.
A.P. : L'alternance de présence et d'absence n'introduit-elle pas une première succession ? De plus, l'absence de la mère fait énigme pour l'enfant : qu'est-ce qui peut l'animer pour qu'elle s'éloigne de lui durant un certain laps de temps ? C'est le phallus qui répond à cette question dans la métaphore paternelle.
E.D. : Oui, l'attribution de l'intention problématise déjà son flux, son désir à elle. Sartre, lorsqu'il était au front, a beaucoup réfléchi à cette question, dans ses Carnets de la drôle de guerre[3] : comment gérer la jalousie inévitable, transcendantale si l'on peut dire, liée au fait que l'autre dispose simplement de son temps. Peu importe d'ailleurs ce qu'il en fait : il peut aller au cinéma, pas forcément avoir des amants, mais cette distance qui est spatiale mais plus profondément temporelle, cette absence qui ronge et mine l'expérience même du simultané, c'est intolérable en soi ! Dans une lettre à Simone de Beauvoir, Sartre écrit en substance que si l'on pouvait faire l'expérience de la simultanéité à l'état pur, on en crèverait…
C.L. : Ça serait la réalisation du rapport sexuel ! Au sens où Lacan dit justement qu'il n'y en a pas…
Ce qui rend la vie respirable
A.P. : La question est donc celle d'un rapport de désir à désir.
E.D. : En effet, il s'agit d'une structure de désir et non pas d'une pure question formelle. Cette coexistence de temps déphasés, distendus, peut être représentée topologiquement, par des lignes qui tracent le diagramme des rythmes de chacun : des temps qui fluent ensemble, se séparent, se croisent et se recroisent. Ces diagrammes peuvent prendre la forme de losanges ou de poches définissant des intervalles topologiques communs (je pense en l'occurrence aux intervalles d'Alexandroff). Si on ne se rejoint pas – si l'un des deux sujets s'éloigne sans retour –, alors une ligne de temps s'interrompt pour l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne se reconnecte pas, l'intervalle topologique ne se referme pas, et c'est là que surgit l'angoisse liée à la perte ou au deuil.
A.P. : Pour penser la coexistence, il faut à la fois de la connexion, et de la déconnexion – et donc, le symbolique qui introduit de la différence – car s'il y a juste de la connexion, on ne fait qu'Un.
E.D. : Oui, mais à l'inverse, quand la distance dépasse un certain seuil dans le temps et l'espace, alors aucune connexion n'est plus possible : il y a un trou qui n'est pas seulement symbolique mais bien réel. La déconnexion au sens physique en fournit un analogon : c'est le cas lorsque deux événements qui par principe ne peuvent être connectés l'un à l'autre par une chaîne causale quelconque parce qu'ils sont à la fois trop loin dans l'espace et trop proches dans le temps. Au XXIe siècle, à l'ère du « temps réel », où l'on est supposé pouvoir entrer en communication instantanée avec tout autre à tout instant, on peut néanmoins repérer toutes sortes de micro-événements ou de micro-structures qui perforent la trame dense des interconnexions, l'éther des flux digitaux… Et tant mieux, car la déconnexion, c'est aussi ce qui permet de respirer !
- Interview retranscrite par Christine Maugin, texte établi par Aurélie Pfauwadel.
- Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 11 décembre 1973, inédit.
- Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, Paris, Gallimard, 1995.